IFLA 2025
Du 10 au 12 septembre 2025, la France a accueilli 1400 participants de plus de 60 pays lors du congrès mondial de l’IFLA, l’événement annuel le plus important pour la profession d’architecte paysagiste et la communauté de l’IFLA.
Le 61e congrès mondial de l’IFLA a proposé des conférences plénières, des sessions parallèles, une compétition étudiante, des visites de site, une zone d’exposition pour les partenaires ainsi que des moments festifs. Autant d’occasions pour nouer des contacts et de rencontrer des professionnels du monde entier.

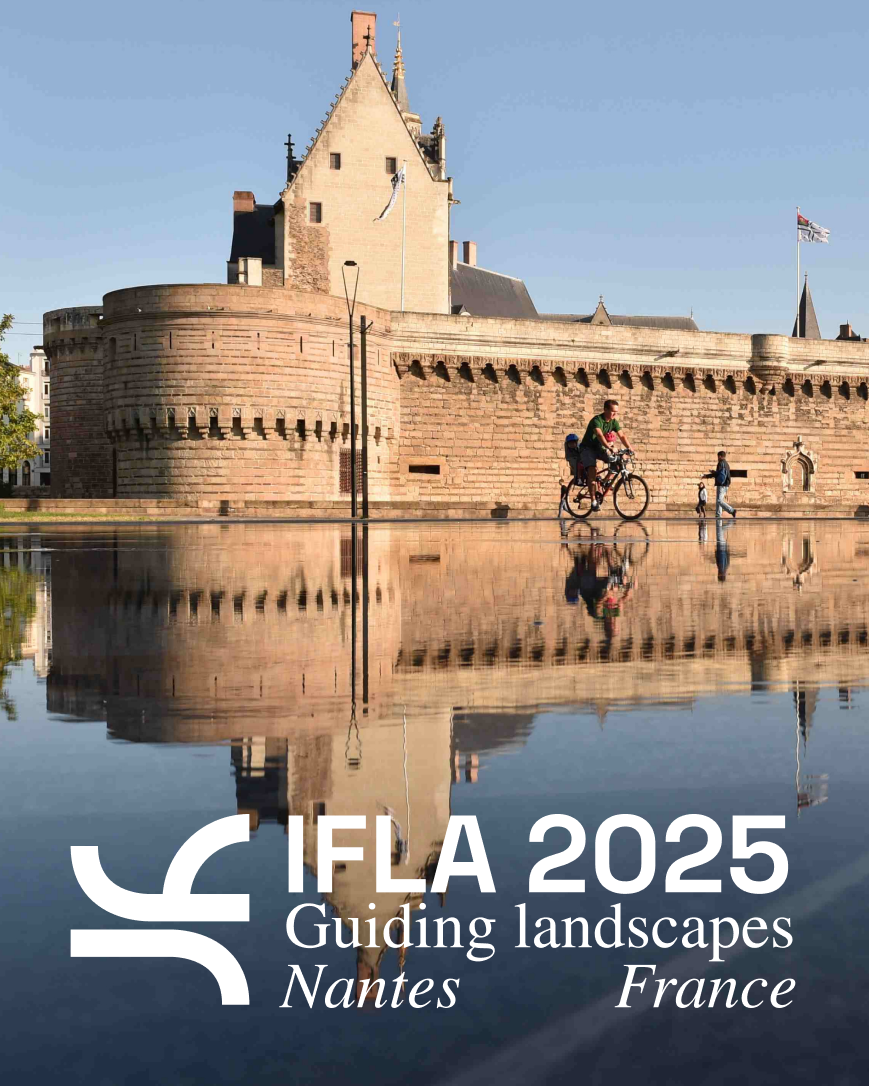
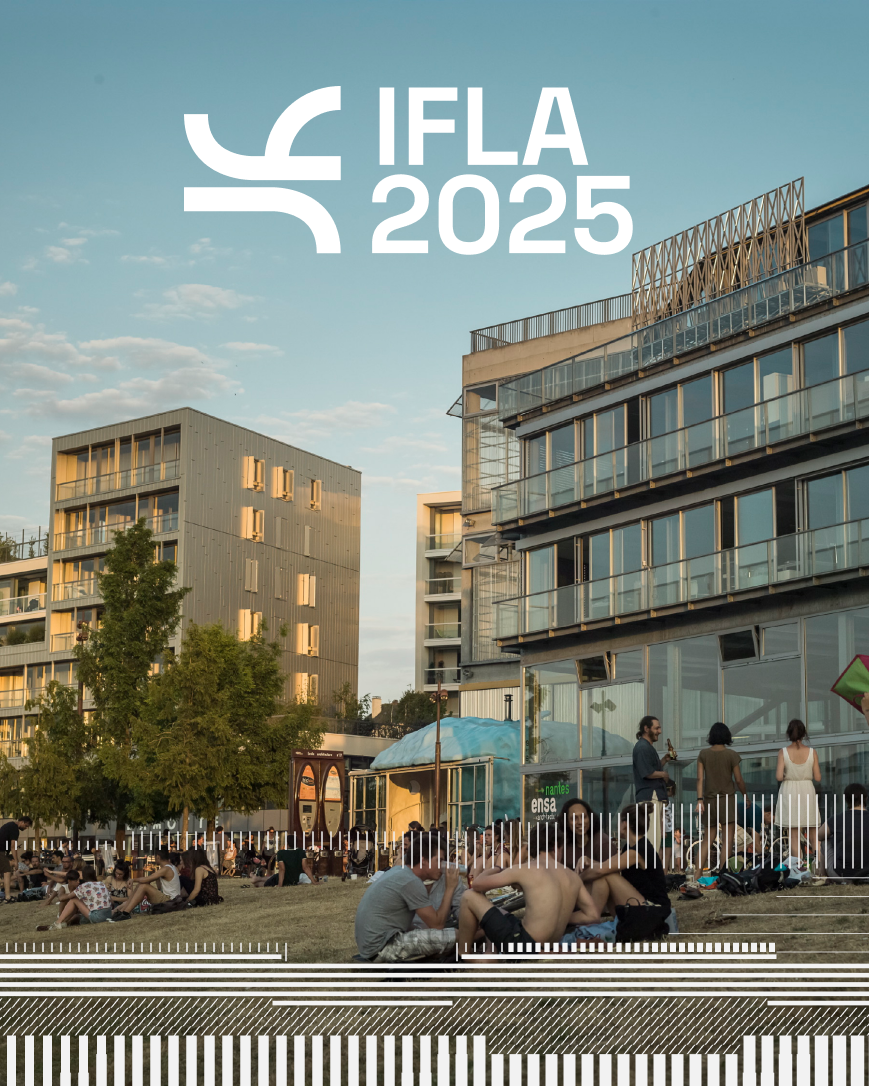
Guider par les paysages
Le congrès d’IFLA WORLD 2025 à Nantes interviendra dans un contexte de changement climatique planétaire, où l’adaptation et la résilience des villes et des territoires nécessite des transformations profondes et systémiques.
La profession d’architecte-paysagiste joue un rôle central dans ces efforts, en mettant en avant des approches urbaines qui favorisent les sols vivants, la biodiversité et une gestion durable de l’eau.
Elle intervient à toutes les échelles du territoire métropolitain, agro-forestier, industriel ou/et naturel, afin d’anticiper les changements environnementaux par des démarches participatives de projet, rendant les dynamiques de transformation appropriables par les habitants.
Afin d’accompagner les territoires dans leur transformation, des solutions basées sur la nature sont développées par les architectes-paysagistes : ils utilisent pour ce faire toutes les sources possibles d’informations socio-environnementales, les data-systèmes et autres outils numériques qui, liés à l’intelligence artificielle, viennent aujourd’hui compléter les outils de relevés et de représentation déjà à leur disposition pour leurs projets.
Le congrès IFLA NANTES 2025 est l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques et réflexions portées dans les différentes parties du monde, à la fois par les praticiens et les chercheurs, afin de rendre nos actions, et celles des professionnels associés, encore plus vertueuses et efficientes.
Henri BAVA, Président de la Fédération Française du Paysage
Temps forts du Congrès
Après un discours d’ouverture prononcé par Johanna Rolland, maire et présidente de Nantes Métropole, le Congrès a démarré par la remise du Sir Geoffrey Jellicoe Award 2025 à Günther Vogt, qui a présenté un panorama de ses réalisations et de sa démarche de conception (nature artificielle au siège de la FIFA de Zurich, projet Masoal Rainforest, Novartis Training center, abords du Tate Modern Museum).
Jacqueline Osty a partagé sa vision du paysage comme point de départ du projet urbain, en articulant nature, formes urbaines et usages, et en rappelant l’importance du sol comme ressource vivante, de par ses réalisations emblématiques (Clichy-Batignolles, Rouen Flaubert, Île de Nantes). Charles Waldheim, créateur du « landscape urbanism« , a questionné les pratiques paysagères en France et dans le monde anglo-saxon, en soulignant l’évolution du rôle du paysagiste, de simple créateur de décors à concepteur visionnaire préparant l’avenir. Il rappelle l’influence des grands projets français et la place déterminante des architectes-paysagistes dans l’aménagement des villes et des territoires.
La deuxième journée animée par Pierre Darmet (UNEP) a été marquée par l’intervention de Cecil Konijnendijk, rappelant avec force la règle du 3-30-300 qu’il a édictée : chaque citoyen doit pouvoir voir au moins trois arbres depuis son logement, vivre dans un quartier doté de 30 % de canopée et accéder à un parc situé à moins de 300 mètres de son domicile. Marc-André Selosse a montré que la vie, des cellules humaines aux sols et aux océans, repose sur une biodiversité microbienne essentielle mais en recul ; combien microbes, champignons et biofilms nourrissent, protègent et régulent les écosystèmes, plaidant pour « plus de sols, plus de plantes ». Miguel Georgieff a présenté son concept de « jardiniers planétaires » et les démarches collectives et évolutives, réalisées avec l’atelier Coloco, où l’esthétique du vivant prime, comme à Saint-Étienne ou Palerme. Enfin, Rainer Stange a illustré l' »urbanisme de ruisseau » à travers le programme de réouverture des rivières à Oslo, jadis canalisées, générant des promenades-parcs, véritables vecteurs de qualité de vie en ville. Romaric Perrocheau, chef jardinier de la Ville de Nantes, a présenté, pour clôturer la journée, une conférence ouverte à tous publics, accueillant Jean Viard, à l’occasion de son dernier ouvrage : L’individu écologique.
La troisième journée animée par Karin Helms a offert un dialogue d’exception entre la recherche de Pepa Morán sur les paysages du feu et la vision planétaire de Kongjian Yu, qui étend son concept de « sponge cities » par des réalisations à très grande échelle. Dirk Sijmons a présenté sa pensée « Navigating the Waves of the Anthropocene » où nature et culture sont intrinsèquement liées, allant du post-humanisme à des solutions régénératives basées sur la nature pour protéger l’humain. Bertrand Folléa a souligné que le paysage doit évoluer de simple accompagnateur à paysage anticipateur, capable de relier climat, eau, urbanisation et usages sociaux pour soutenir la transition écologique, en mettant en avant l’importance des espaces de lisières.
Les participants ont pu écouter les différents paysagistes ayant travaillé au réaménagement de l’Île de Nantes, projet urbain de longue durée où la continuité, la constitution d’un plan-guide et la valorisation de l’existant ont structuré la transformation du territoire. Ariella Masboungi a animé les échanges autour des interventions de Virginie Vial, Sylvanie Gree et Alexandre Chemetoff et a également demandé à Jacqueline Osty de les rejoindre. Le débat a mis en lumière l’importance de l’alliance entre ville et nature, la participation citoyenne et l’adaptation aux crises et aux enjeux écologiques. L’approche combine sobriété, régénération et créativité, faisant de chaque réalisation un acte intégré dans un projet global et évolutif.